
Cette étude anthracologique fait suite à l’opération archéologique effectuée sur le « Grand Sanctuaire » du site de Gisacum au Vieil-Evreux (27) en 2018. Cette opération triennale a été menée par la Mission Archéologique Départementale de l’Eure. La fouille a été dirigée par Sandrine Bertaudière, archéologue de la Mission Archéologique Départementale.
L’étude
anthracologique porte sur une sélection de 60 prélèvements
charbonneux. 19 lots ont été prélevés à l’intérieur du
comblement du « second puisard » (Sondage 51) et 41 lots
proviennent des sondages situés devant le temple central (S39 et
S42).
L’attribution chronologique des lots s’étend sur la période allant de la phase II.5c (vers le milieu du IIIe siècle) à la phase III.2 (IVe siècle). Les prélèvements du sondage 51 (comblement du conduit du second puisard) correspondent plus précisément à la phase III.1 à III.2.
Les restes anthracologiques proviennent de 60 prélèvements réalisés dans les sondages S39, S42 et S51. Environ 2000 charbons ont été étudiés.
28 taxons anthracologiques ont été identifiés dans cette étude : la plupart de ces taxons ont été identifiés dans les lots du puisard (S51) durant la phase III.1 et III.2 (entre 280 et 380 ap. J.-C.). Sept taxons ont été déterminés dans les couches situées devant le temple central (sondage S39) mais les effectifs étudiés étaient moins importants.
Si
l’on écarte les prélèvements de la phase II.5c, dont les lots
étaient peu importants et composés principalement de chêne
(Quercus sp.), du genre Prunus et de résineux avec le
sapin (Abies sp.) et le pin (Pinus sp.), les compositions
anthracologiques des périodes II.5d, III.1 et III.2 sont dominées
par cinq taxons : le chêne (Quercus sp.), le
genre Prunus sp. (prunellier,
merisier, cerisier), le
frêne(Fraxinus
sp.), les
Pomoïdées etl’érable(Acer sp.).
D’autres
taxons ont ensuite été identifiés de façon régulière durant ces
trois phases : le hêtre(Fagus
sylvatica), le
noisetier(Corylus
avellana), le
bouleau(Betula
sp.), le
tilleul(Tilia
sp.)l’orme
(Ulmus sp.), le
tilleul (Tilia sp.),
le sureau(Sambucus
sp.), le
cornouiller(Cornus
sp.), l’orme
(Ulmus sp.), le sapin
(Abies sp.), le pin
(Pinus sp. dont Pinus
type pinea ou type
pinaster et des résineux non
identifiés : Gymnosperme),le
buis (Buxus sp.), le
genévrier (Juniperus sp.),
la famille des bruyères (Ericaceae),
le genêt (Fabaceae type Cytisus),
le fusain (Euonymus europaeus),
le nerprun (Rhamnus catharticus),
le charme (Carpinus betulus),
le chêne-châtaignier (Quercus sp. – Castanea sp.),
le saule (Salix sp.),
le saule – peuplier (Salix sp. – Populus sp.),
la viorne (Viburnum sp.).
Notons
que ces derniers taxons ne sont parfois représentés que par
quelques occurrences.
L’identification
des taxons ligneux permet de proposer différentes associations
écologiques (Rameau et
al.,
1989) :
-
le groupement forestier de la
chênaie diversifiée avec le chêne (Quercus sp.), le
chêne-châtaignier (Quercus sp. / Castanea sp.),
l’érable (Acer sp.), l’orme (Ulmus sp.), le tilleul
(Tilia sp.), le charme (Carpinus betulus) et le
groupement de la chênaie-hêtraie avec le chêne (Quercus
sp.), le hêtre (Fagus sp.), l’érable (Acer sp.)
et le frêne (Fraxinus sp.), voire le sapin (Abies alba).
Notons que le
groupement de la chênaie-hêtraie est détecté dans la plupart des
prélèvements. Il correspond au groupement forestier
caractéristique de la période du Subatlantique, largement détecté
par la palynologie et majoritaire dans le nord-ouest de la France
(Gaudin, 2004).
-
les
« landes-fourrés », lisières forestières, haies,
associations héliophiles :
avec la détection des Pomoïdées,Prunoïdées
(Prunus
sp.),
du sureau (Sambucus
sp.),
noisetier (Corylus
avellana),
du cornouiller (Cornus
sp.),
du nerprun (Rhamnus
catharticus),
du fusain (Euonymus
europaeus),
du genévrier (Juniperus
sp.),
du buis (Buxus
sp.).
Le genêt (Fabaceae
type Cytisus)
et les Ericaceae sont plutôt synonymes de landes. Ces végétations
attestent l’existence d’espaces ouverts ou clairsemés dans l’aire
de ramassage. Les communautés végétales de landes et la détection
régulière du noisetier correspondent probablement aux premiers
stades de recolonisation végétale d’espaces exploités puis
abandonnés.
-
les
boisements hygrophiles
sont perçus avec le frêne (Fraxinus
sp.),
le saule (Salix
sp.),
le saule / peuplier (Salix
sp. / Populus sp.),
l’orme (Ulmus
sp.),
la viorne (Viburnum
sp.).
Ces boisements pourraient provenir d’une zone humide, de bord de
cours d’eau ou depuis la zone alluviale de l’Iton ou de l’Eure.
-
Plantes
importées, favorisées, ornementales (?) :
le sureau (sambucus
sp.),
le genre prunus
sp., les
Pomoïdées ont pu être favorisés pour leurs fruits. Le buis
(Buxus
sp.),
le genévrier ont pu être utilisés comme plantes ornementales.
Enfin, plusieurs résineux ont été détectés. Si le sapin pectiné
(Abies
alba),
le pin sylvestre (Pinus
type sylvestris / mugo / nigra),
voire le genévrier (Juniperus
sp.)
sont peut être subspontanés dans la région (?), quelques
fragments de pin type pinea
ou pinaster
(?)
sont plus probablement d’origine méridionale.
Notons
que la plupart
des taxons et l’ensemble de ces formations ligneuses avaient aussi
été reconnus lors d’une précédente étude anthracologique
(Gaudin, 2018). Cette étude portait sur des prélèvements du
sondage 39 et du comblement d’un premier puisard (sondage S 28)
datés de la phase III.1.
Il
n’a pas toujours été possible de percevoir l’ensemble des
formations ligneuses pour chacune des périodes. En effet, seuls les
boisements de type chênaie et les boisements héliophiles ont été
identifiés pour la phase II.5c (Fig. 117), mais cette période est
moins « pourvue » en échantillons. En revanche,
l’ensemble des formations ligneuses a été perçu durant les autres
phases II.5d, III.1 et III.2 (Fig. 118, 119 et 120), ce qui montre
une stabilité de l’aire de ramassage mais aussi de l’environnement
boisé au moins durant ces trois phases.
Les
mesures de largeurs de cerne réalisées sur les fragments de chêne
de gros et moyen calibre ont permis de calculer des moyennes de
largeurs de cerne pour une vingtaines de prélèvements. Nous
constatons des valeurs moyennes assez homogènes, centrées
majoritairement entre 1 et 2 mm. Ces valeurs correspondent à des
croissances difficiles, en liaison avec des contextes abiotiques (ex.
sols pauvres, météorologie,…) et/ou biotiques (compétition vis à
vis des ressources, ex. chênaie dense) contraignants. Aucune
évolution des largeurs moyennes n’est perceptible entre les phases
II.2d, III.1 et III.2, ce qui laisse penser là aussi à une
stabilité de la structure du paysage environnant, mais aussi de
l’aire de collecte du bois de chêne.
En ce qui concerne le calibre du bois utilisé, nous constatons pour l’ensemble des prélèvements une majorité de fragments montrant des courbures de cerne fortes et intermédiaires. Quelques charbons de sections entières allant de quelques millimètres à 4 cm ont régulièrement été observés. Des calculs de diamètres minimum ont été réalisés sur plusieurs lots (P02-1206, P02-1204, P02-1210). Ils ont permis d’estimer des diamètres allant de 40 mm à 100 mm. Les fragments montrant des courbures de cerne faibles sont assez rares, ils correspondent généralement à du chêne. C’est donc avant tout du bois de branches, voire de brindilles qui a globalement été utilisé sur l’ensemble des phases II.5c à III.2. Seuls quelques charbons de chêne pourraient provenir de bois de gros calibre mais qui n’ont dû être utilisés que ponctuellement…
Lien vers le rapport.
 Ce document présente les résultats des tests palynologiques de huit prélèvements réalisés lors de la fouille du bassin antique du site de Saint-Martin-du-Val à Chartres (28), opération archéologique C128.19. Ce rapport vise à estimer le contenu palynologique des prélèvements dans l’optique de faire des analyses plus approfondies.
Ce document présente les résultats des tests palynologiques de huit prélèvements réalisés lors de la fouille du bassin antique du site de Saint-Martin-du-Val à Chartres (28), opération archéologique C128.19. Ce rapport vise à estimer le contenu palynologique des prélèvements dans l’optique de faire des analyses plus approfondies.
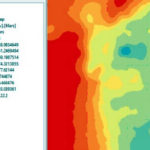
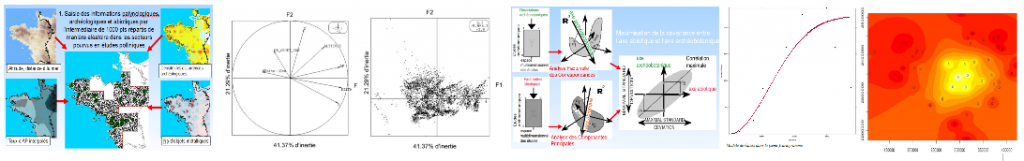
 Ce document présente les résultats d’analyses de restes charbonneux retrouvés dans les comblements de dix structures archéologiques du site « Le Plain Gruchet » à Goustranville (14). Neuf de ces structures sont en lien avec différentes phases du système technique de la crémation pratiqué durant le 1er siècle ap. J.-C dans les environs de Caen. Ces structures sont en effet interprétées comme les vestiges de fosses-bûchers, fosses de rejets de bûcher, fosses avec vase-ossuaire… Une structure serait en revanche davantage associée à des activités de métallurgie. (Fig. 2).
Ce document présente les résultats d’analyses de restes charbonneux retrouvés dans les comblements de dix structures archéologiques du site « Le Plain Gruchet » à Goustranville (14). Neuf de ces structures sont en lien avec différentes phases du système technique de la crémation pratiqué durant le 1er siècle ap. J.-C dans les environs de Caen. Ces structures sont en effet interprétées comme les vestiges de fosses-bûchers, fosses de rejets de bûcher, fosses avec vase-ossuaire… Une structure serait en revanche davantage associée à des activités de métallurgie. (Fig. 2). 

